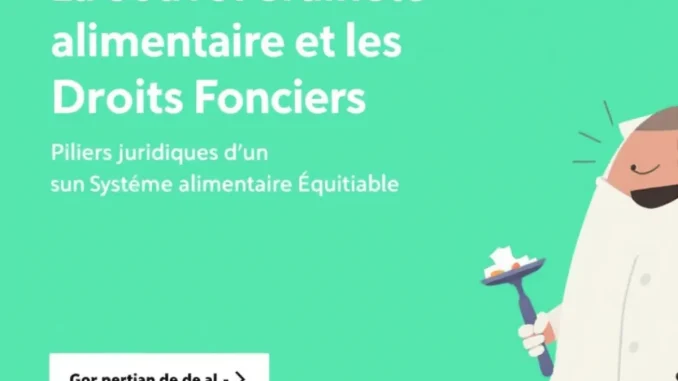
La souveraineté alimentaire représente un paradigme juridique qui reconnaît aux peuples le droit de définir leurs propres systèmes alimentaires et agricoles. Ce concept, né des mouvements paysans internationaux dans les années 1990, se distingue de la simple sécurité alimentaire en intégrant des dimensions de justice sociale et d’autodétermination. Parallèlement, les droits fonciers constituent la pierre angulaire de cette souveraineté en garantissant l’accès, le contrôle et la propriété des terres. L’interconnexion de ces deux notions forme un cadre juridique complexe où s’entrecroisent droit international, législations nationales et pratiques coutumières. Face aux défis contemporains comme l’accaparement des terres et le changement climatique, l’analyse de cette relation devient fondamentale pour comprendre les enjeux juridiques de l’alimentation mondiale.
Fondements Juridiques de la Souveraineté Alimentaire
La souveraineté alimentaire s’est progressivement inscrite dans le paysage juridique international, bien que sa reconnaissance formelle demeure inégale selon les systèmes juridiques. Conceptualisée par le mouvement paysan international La Via Campesina lors du Sommet mondial de l’alimentation de 1996, elle constitue une réponse aux politiques de libéralisation agricole promues par l’Organisation mondiale du commerce. Sa définition juridique s’articule autour du droit des peuples à une alimentation culturellement appropriée, produite selon des méthodes écologiquement saines.
Sur le plan normatif, plusieurs instruments juridiques internationaux soutiennent indirectement ce concept. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) reconnaît dans son article 11 le droit fondamental de toute personne d’être à l’abri de la faim. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans adoptée en 2018 représente une avancée majeure en reconnaissant explicitement le droit à la souveraineté alimentaire dans son article 15.4. Cette déclaration, bien que non contraignante, fournit un cadre normatif progressiste qui influence l’évolution des législations nationales.
Au niveau régional, l’Union africaine a intégré des éléments de souveraineté alimentaire dans sa politique agricole commune, tandis que certains pays d’Amérique latine comme l’Équateur, la Bolivie et le Venezuela ont constitutionnalisé ce concept. L’Équateur fut pionnier en inscrivant la souveraineté alimentaire dans sa constitution de 2008 (articles 281 et 282), créant ainsi une obligation juridique pour l’État de promouvoir des politiques qui la garantissent.
La jurisprudence internationale commence à intégrer cette notion. La Cour interaméricaine des droits de l’homme a développé une interprétation extensive du droit à l’alimentation dans l’affaire Communauté autochtone Yakye Axa c. Paraguay (2005), reconnaissant le lien intrinsèque entre accès à la terre et souveraineté alimentaire pour les peuples autochtones. De même, le Tribunal international Monsanto, bien que n’étant pas une juridiction officielle, a contribué à façonner l’opinion juridique sur les questions de souveraineté alimentaire face aux droits de propriété intellectuelle des semences.
Les principes juridiques structurants
- Le principe d’autodétermination alimentaire des peuples
- La reconnaissance des droits collectifs sur les ressources naturelles
- La primauté du droit à l’alimentation sur les règles commerciales
- La protection juridique des savoirs traditionnels agricoles
L’évolution de ces fondements juridiques témoigne d’une tension constante entre deux visions du droit : l’une privilégiant la libéralisation des marchés agricoles sous l’égide de l’OMC, l’autre défendant un cadre juridique protecteur des droits des communautés locales et de leur autonomie alimentaire. Cette dialectique se manifeste dans les négociations internationales sur l’agriculture, où la souveraineté alimentaire s’oppose au paradigme dominant de sécurité alimentaire basé sur le commerce international.
Régimes Fonciers et Protection Juridique des Terres Agricoles
Les régimes fonciers constituent l’architecture juridique qui détermine comment les terres sont détenues, utilisées et transférées. Cette architecture varie considérablement entre les systèmes juridiques, oscillant entre la propriété privée absolue et les formes communautaires de tenure. La sécurisation foncière, pilier de la souveraineté alimentaire, requiert des mécanismes juridiques adaptés aux réalités socioculturelles des territoires.
Dans de nombreux pays du Sud global, le pluralisme juridique caractérise la gouvernance foncière, avec une coexistence parfois conflictuelle entre droit positif et systèmes coutumiers. Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers adoptées par la FAO en 2012 proposent un cadre normatif pour réconcilier ces systèmes. Elles recommandent la reconnaissance légale des droits fonciers légitimes, même lorsqu’ils ne sont pas formellement enregistrés, approche adoptée par le Rwanda dans sa réforme foncière de 2005.
La protection juridique des terres agricoles s’articule autour de plusieurs dispositifs. Les zones agricoles protégées (ZAP) en France ou les agricultural land reserves au Canada illustrent comment le droit de l’urbanisme peut préserver les surfaces cultivables. Le Japon a développé un système complexe de classification des terres agricoles avec des restrictions graduées sur leur conversion à d’autres usages. Ces mécanismes juridiques visent à contrer l’artificialisation des sols, menace directe à la souveraineté alimentaire.
Les droits d’usage collectifs représentent une forme juridique particulièrement pertinente pour la souveraineté alimentaire. En Amérique latine, les terres ejidales au Mexique ou les territoires indigènes en Colombie bénéficient d’un statut juridique spécial qui limite leur aliénation. Le Brésil a développé le concept juridique de fonction sociale de la propriété qui permet l’expropriation des terres improductives pour la réforme agraire, bien que son application reste politiquement contestée.
Innovations juridiques en matière de protection foncière
- Les servitudes environnementales et agricoles perpétuelles
- Les fiducies foncières communautaires (community land trusts)
- Les baux ruraux environnementaux avec clauses agroécologiques
- Les droits d’usage collectifs inscrits dans les cadastres modernes
Face à la financiarisation croissante du foncier agricole, certains systèmes juridiques ont développé des mécanismes de régulation des transactions. Les SAFER (Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural) en France disposent d’un droit de préemption sur les ventes de terres agricoles, permettant de maintenir leur vocation productive. De même, plusieurs juridictions comme le Québec ou la Suisse ont adopté des législations limitant l’acquisition de terres agricoles par des entités non-agricoles ou étrangères, créant ainsi un bouclier juridique contre la spéculation foncière.
L’Accaparement des Terres : Défis Juridiques et Réponses Normatives
L’accaparement des terres (land grabbing) constitue l’un des obstacles majeurs à la réalisation de la souveraineté alimentaire. Ce phénomène, caractérisé par l’acquisition à grande échelle de terres agricoles par des investisseurs étrangers ou des entreprises multinationales, soulève d’importantes questions de droit international et de protection des droits fondamentaux. L’ONG GRAIN a documenté plus de 500 cas impliquant plus de 30 millions d’hectares depuis 2008, majoritairement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est.
Sur le plan du droit international des investissements, les traités bilatéraux d’investissement (TBI) offrent souvent une protection juridique robuste aux investisseurs étrangers sans imposer d’obligations équivalentes concernant les droits des communautés locales. L’affaire Pac Rim Cayman LLC c. République du Salvador illustre cette asymétrie juridique : l’entreprise minière a poursuivi le gouvernement salvadorien pour avoir refusé un permis d’exploitation susceptible de compromettre les ressources en eau et la production alimentaire locale. Bien que le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) ait finalement tranché en faveur du Salvador en 2016, ce cas souligne la tension entre protection des investissements et souveraineté alimentaire.
Les Principes pour un investissement agricole responsable (PRAI) élaborés par la FAO, la CNUCED, le FIDA et la Banque mondiale tentent d’établir un cadre normatif pour encadrer ces acquisitions. Toutefois, leur caractère non contraignant limite leur efficacité. Plus prometteurs sont les développements juridiques nationaux visant à restreindre les acquisitions massives. L’Ouganda a adopté en 2013 une politique foncière nationale qui limite la taille des concessions accordées aux investisseurs étrangers et impose des évaluations d’impact social. La Tanzanie a révisé sa législation pour exiger qu’une portion des terres acquises par des investisseurs soit réservée aux petits producteurs locaux.
La jurisprudence régionale africaine marque des avancées significatives. Dans l’affaire Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a reconnu en 2010 que l’expropriation des terres traditionnelles du peuple Endorois sans consultation adéquate ni compensation juste violait leurs droits fondamentaux, incluant leur droit à l’alimentation. Cette décision établit un précédent juridique important contre l’accaparement des terres.
Mécanismes juridiques de protection contre l’accaparement
- L’obligation de consultation préalable, libre et éclairée des communautés affectées
- Les clauses de performance sociale et environnementale dans les contrats d’investissement
- Les plafonnements légaux de superficie acquérable par des entités étrangères
- Les procédures d’évaluation d’impact sur la souveraineté alimentaire locale
Au niveau du contentieux international, on observe une évolution vers une meilleure prise en compte des droits des communautés. La Cour de justice de la CEDEAO a rendu en 2017 une décision historique dans l’affaire SERAP c. République fédérale du Nigeria, condamnant les dégradations environnementales causées par des compagnies pétrolières qui compromettaient la production alimentaire dans le delta du Niger. Cette jurisprudence régionale émergente pourrait inspirer d’autres juridictions face aux menaces que l’accaparement des terres fait peser sur la souveraineté alimentaire.
Droits des Peuples Autochtones et Systèmes Alimentaires Traditionnels
Les peuples autochtones, qui représentent environ 5% de la population mondiale mais protègent 80% de la biodiversité restante selon l’ONU, entretiennent une relation particulière avec leurs terres ancestrales. Cette relation, fondement de leurs systèmes alimentaires traditionnels, bénéficie d’une protection juridique spécifique en droit international. La Convention 169 de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux (1989) et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (2007) constituent le socle normatif de cette protection.
L’article 26 de la Déclaration reconnaît explicitement « le droit de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent parce qu’ils leur appartiennent ou qu’ils les occupent ou les utilisent traditionnellement ». Ce cadre juridique international a influencé les réformes constitutionnelles dans plusieurs pays. La Bolivie et l’Équateur ont reconnu dans leurs constitutions respectives le concept de Buen Vivir (Sumak Kawsay), vision autochtone qui intègre souveraineté alimentaire et harmonie avec la nature. La Colombie a établi le statut juridique des resguardos indígenas, territoires collectifs inaliénables.
La jurisprudence internationale a progressivement consolidé ces droits. L’arrêt fondateur Communauté Mayagna (Sumo) Awas Tingni c. Nicaragua rendu par la Cour interaméricaine des droits de l’homme en 2001 a reconnu les droits de propriété collective sur les terres ancestrales. Cette jurisprudence s’est enrichie avec l’affaire Peuple Saramaka c. Suriname (2007), où la Cour a établi l’obligation pour les États d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des communautés autochtones avant tout projet affectant leurs territoires et ressources. Ces décisions juridiques renforcent les fondements légaux de la souveraineté alimentaire des peuples autochtones.
La protection juridique des savoirs traditionnels liés à l’agriculture et à l’alimentation représente un autre aspect fondamental. Face à la biopiraterie et à l’appropriation des ressources génétiques, plusieurs mécanismes juridiques ont émergé. Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (2010) établit un cadre contraignant pour le partage des bénéfices issus de l’exploitation commerciale des ressources génétiques et des savoirs associés. Le Pérou a développé un régime juridique sui generis avec sa Loi 27811 qui protège les connaissances collectives des peuples autochtones liées aux ressources biologiques, incluant les pratiques agricoles traditionnelles.
Mécanismes juridiques de protection des systèmes alimentaires autochtones
- La reconnaissance constitutionnelle des territoires autochtones
- Les protocoles bioculturels communautaires juridiquement reconnus
- Les registres de savoirs traditionnels agricoles protégés
- Les indications géographiques adaptées aux produits alimentaires autochtones
L’interaction entre systèmes juridiques étatiques et droit coutumier autochtone constitue un défi persistant. Le pluralisme juridique offre une voie prometteuse, comme l’illustre la Nouvelle-Zélande qui a accordé en 2017 la personnalité juridique au fleuve Whanganui, reconnaissant ainsi la vision Maori de l’indivisibilité entre communautés, alimentation et écosystèmes. Cette approche juridique novatrice pourrait inspirer de nouvelles formes de protection légale des systèmes alimentaires traditionnels, fondements vivants de la souveraineté alimentaire.
Vers un Droit à la Souveraineté Alimentaire: Perspectives d’Évolution Juridique
L’émergence progressive d’un droit à la souveraineté alimentaire représente une évolution significative du cadre juridique international relatif à l’alimentation. Contrairement au droit à l’alimentation, déjà bien établi dans les instruments juridiques internationaux, le droit à la souveraineté alimentaire intègre des dimensions de contrôle démocratique et d’autodétermination des systèmes alimentaires. Cette conceptualisation juridique nouvelle s’inscrit dans ce que certains juristes qualifient de « troisième génération de droits humains », caractérisée par sa dimension collective.
La constitutionnalisation de la souveraineté alimentaire dans plusieurs pays du Sud global témoigne de cette évolution. Outre l’Équateur et la Bolivie déjà mentionnés, le Népal a inscrit ce principe dans sa constitution de 2015 (article 36), tandis que le Mali a adopté en 2006 une Loi d’orientation agricole qui reconnaît explicitement la souveraineté alimentaire comme objectif de politique publique. Ces avancées normatives nationales influencent progressivement le droit international par un phénomène que les juristes nomment « fertilisation juridique croisée ».
Au niveau des juridictions régionales, on observe une interprétation évolutive des droits existants. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, dans sa résolution 431 adoptée en 2019, a appelé les États membres à « élaborer des cadres juridiques qui protègent les droits des communautés sur leurs terres ancestrales et garantissent leur souveraineté alimentaire ». Cette approche téléologique du droit existant permet d’intégrer progressivement les principes de souveraineté alimentaire sans nécessiter l’adoption de nouveaux traités internationaux.
Le développement d’un droit agroécologique constitue une autre tendance prometteuse. La France a introduit dans son Code rural la notion d’agroécologie (Loi d’avenir pour l’agriculture de 2014), créant ainsi un cadre juridique favorable aux pratiques agricoles durables qui sous-tendent la souveraineté alimentaire. Le Brésil a adopté en 2012 une Politique nationale d’agroécologie et de production biologique qui établit des mécanismes juridiques pour la transition vers des systèmes alimentaires plus autonomes et résilients. Ces innovations juridiques nationales préfigurent l’émergence d’un corpus normatif international sur l’agroécologie.
Pistes pour un cadre juridique renforcé de la souveraineté alimentaire
- L’élaboration d’une convention-cadre internationale sur la souveraineté alimentaire
- Le développement de clauses de sauvegarde pour la souveraineté alimentaire dans les accords commerciaux
- La création d’un rapporteur spécial des Nations Unies sur la souveraineté alimentaire
- L’intégration de critères de souveraineté alimentaire dans les études d’impact des projets de développement
Les tribunaux d’opinion comme le Tribunal permanent des peuples contribuent à l’évolution du droit en formulant des avis juridiques innovants sur la souveraineté alimentaire. Lors de sa session sur les violations des droits des paysans (2011), ce tribunal a qualifié les atteintes à la souveraineté alimentaire de « crimes contre l’humanité » lorsqu’elles entraînent des famines ou des déplacements forcés massifs. Bien que non contraignantes, ces positions juridiques avant-gardistes influencent progressivement la doctrine et la pratique du droit international.
L’interaction entre droits fonciers et souveraineté alimentaire s’inscrit désormais dans le contexte plus large des transitions écologiques. Le développement d’un droit climatique sensible aux enjeux alimentaires représente un front juridique émergent. La reconnaissance par l’Accord de Paris de « la priorité fondamentale consistant à protéger la sécurité alimentaire » (article 2) ouvre la voie à l’intégration des principes de souveraineté alimentaire dans les instruments juridiques climatiques. Cette convergence normative pourrait renforcer considérablement la protection juridique des systèmes alimentaires locaux face aux bouleversements environnementaux mondiaux.
